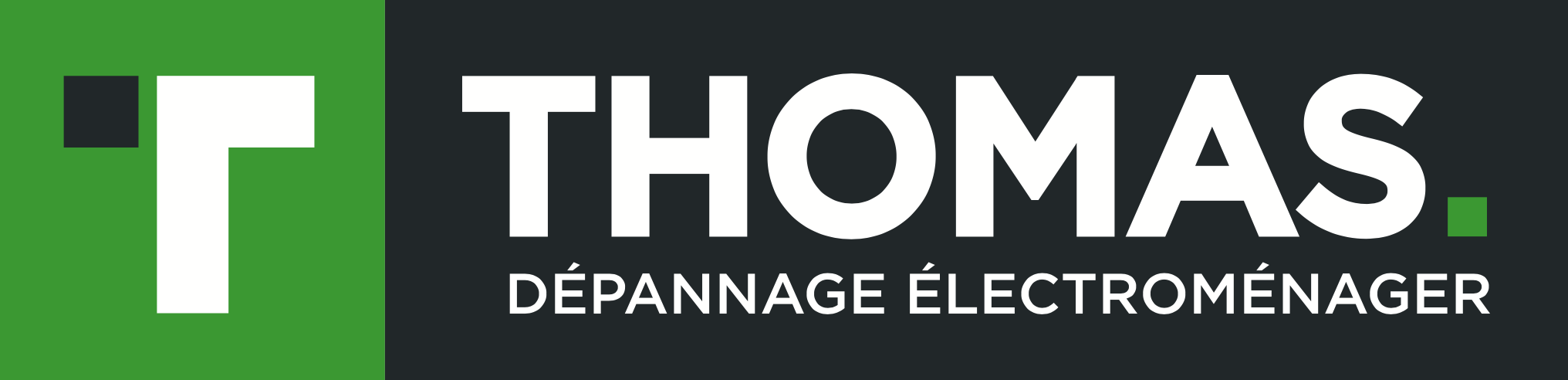Dépannage Electroménager TV/HIFI/VIDÉO…
Vente de pièces détachées et accessoires
Nous contacter
02 47 41 01 60
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et 17h le vendredi.
Particuliers
À domicile ou en atelier, nous nous occupons du dépannage de vos appareils, petits ou gros électroménagers, TV, Hi-Fi, Vidéo…
Professionnels
Pour tout savoir sur le suivi d’un dossier ou faire une demande de réparation …
Du diagnostic à la réparation, nos techniciens interviennent.
À domicile ou en atelier, nous nous occupons du dépannage de vos appareils, petits ou gros électroménagers, TV, Hi-fi, Vidéo…
Agrée par les plus grandes marques, Thomas Dépannage est spécialisé dans la réparation et la vente de pièces détachées, de tous les appareils électroménagers. La proximité avec nos clients est un axe majeur dans notre métier.
Face à l’évolution technologique et soucieux d’assurer un service de qualité nos techniciens sont formés régulièrement par les marques que nous représentons.

Nos engagements et labels partenaires.
Thomas Dépannage est une station technique agréée par les constructeurs, nos techniciens sont formés et suivis par les fabricants. Ils effectuent des réparations sous et hors garantie avec le même souci de qualité et de professionnalisme.
La gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est traitée par notre partenaire « ecosystem ».








Pour nous, réparer est avant tout une démarche éco-responsable.
Chez Thomas Dépannage, nous travaillons aussi pour la protection de l’environnement. La réparation, un enjeu majeur dans la réduction des déchets, est reconnue d’utilité publique.
Ne jetez plus, nous réparons pour prolonger la durée de vie de vos appareils et réduire l’empreinte carbone.
Si votre appareil, déposé dans nos ateliers, est non réparable, nous vous proposons de le confier à un organisme de recyclage. Pour tout autre appareil en fin de vie, déposez le dans une déchetterie afin d’y être recyclé.
Agrée par les plus grandes marques.
L’agrément constitue un gage de qualité pour le client et aussi pour la valorisation de nos équipes.
Thomas Dépannage est une station technique agréée par les constructeurs, nos techniciens sont formés et suivis par les fabricants. Ils effectuent des réparations sous et hors garantie avec le même souci de qualité et de professionnalisme.



















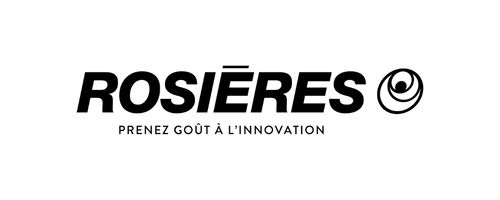

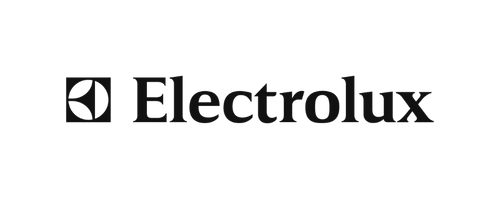



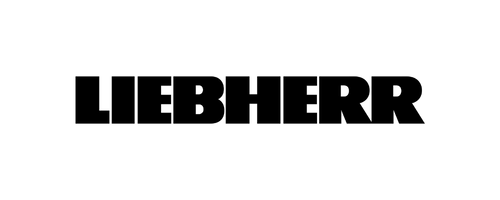
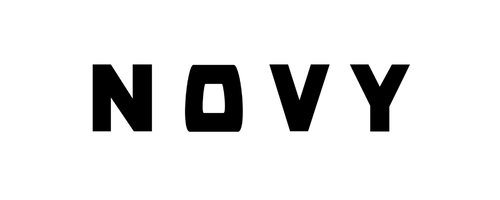


Nos clients témoignent:
“Suite à une panne du moteur de mon réfrigérateur , j’ai fais appel au services de l’entreprise THOMAS. je tenais a les remercier pour leurs réactivité et leur technicien a fait preuve d’un grands professionalisme , du diagnostique a la reparation. je recommande cette entreprise.”
“J’ai eu recours à Thomas Dépannage pour ma plaque de cuisson car le tactile ne fonctionnait plus. J’ai toujours été bien accueillie sur place. Ils ont été très réactifs une fois que la panne a été détectée et que les pièces sont arrivées. Je l’ai récupéré propre et qui fonctionne donc tout va bien.”
“J’ai commandé une embase pour mon mixeur MOULINEX.
Malheureusement l’embase commandée n’était pas la bonne (problème de référence lié à la marque Moulinex ). Ils m’ont repris la mauvaise pièce sans aucun problème.
Accueil des 2 secrétaires étaient très professionnelle et agréable.”